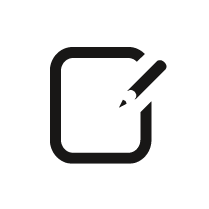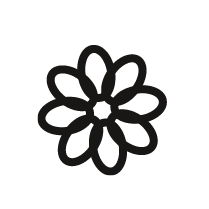(Stage) Comment évaluer la connectivité des prairies humides ? Une approche écologique et génétique
Le Conservatoire botanique national du Massif central (CBN Massif central) est un établissement public agréé par l’État français. Il œuvre principalement à la connaissance et la conservation de la flore sauvage, de la végétation et des habitats naturels et semi-naturels. Il fournit également, dans ces domaines, une assistance technique et scientifique aux services de l’État et aux collectivités territoriales et mène, plus globalement, une politique d’information et d’éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale. Le CBN Massif central exerce ses activités sur un territoire d’agrément constitué de 10 départements du Massif central répartis sur 2 régions administratives (Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine) et assure une mission de coordination biogéographique des actions mises en œuvre par les conservatoires botaniques nationaux pour l’ensemble du territoire du Massif central.
Stage de 6 ou 7 mois, à commencer en janvier 2022.
- Travail de bureau : GEOLAB, Clermont-Ferrand (63).
- Déplacements : A prévoir à l’antenne Rhône-Alpes du Conservatoire Botanique National du Massif central, à Pélussin (42), ainsi qu’à l’Institut de Biologie Végétale de l’Université de Cologne (Allemagne).
Il est aujourd’hui largement admis que préserver des habitats isolés n’est pas suffisant pour permettre la persistance à long terme des espèces dans les paysages : les possibilités de dispersion de ces espèces entre les zones d’habitat favorable doivent pour cela être préservées. Ce constat a mené au concept de Trames Vertes et Bleues, des réseaux de corridors de dispersion et d’habitats interconnectés, aujourd’hui intégrées dans les documents de planification depuis l’échelle nationale, voire internationale, jusqu’à celle de la commune.
Mais cette mise en œuvre se heurte à un double manque de connaissances, d’une part concernant la biodiversité présente sur les territoires, et d’autre part concernant la fonctionnalité des connectivités écologiques. Pour la flore, l’évaluation des capacités de dispersion des espèces végétales est complexe, ce qui conduit souvent à laisser ces espèces de côté lors de la mise en place d’actions concrètes portant sur les continuités écologiques. Pourtant, les recherches récentes ont mis en avant l’importance de la connectivité du paysage pour la persistance à moyen et long terme de ces espèce végétales. La flore jouant à son tour un rôle clé pour de nombreuses espèces animales, notamment des insectes, il est important d’améliorer les connaissances concernant les capacités de dispersion des espèces végétales et les éléments du paysage susceptibles de faciliter ou de limiter leurs déplacements.
Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat », le Conservatoire botanique national du Massif central réalise avec le laboratoire de recherche GEOLAB de l’Université de Clermont-Ferrand et l’Institut de Biologie Végétale de l’Université de Cologne une étude portant sur la connectivité des prairies humides sur trois sites (le plateau mornantais, dans le Rhône, le plateau pélussinois, dans la Loire, et le plateau annonéen, en Ardèche). Ces sites hébergent un réseau encore relativement important de prairies humides remarquables, avec plusieurs espèces végétales protégées. La conservation du bon état écologique de ces prairies est d'autant plus importante qu'elles jouent également un rôle essentiel pour la faune et pour la qualité de l'eau.
L'un des volets du projet vise à réaliser une étude de génétique des populations afin d’évaluer la connectivité des prairies pour les espèces végétales. Basée sur une technologie de séquençage innovante, le RAD sequencing, permettant d’obtenir des informations à une résolution très fine, cette approche permettra de reconstruire les réseaux de parenté des individus échantillonnés afin d’évaluer les éléments influençant leur dispersion. L’un des enjeux de l’étude consistera à adapter cette technologie, généralement utilisée sur des espèces modèles, pour des espèces de prairie humide dans une approche de conservation.
Le stage proposé consistera à génotyper des échantillons de trois espèces de plantes de prairies humides (le Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi, l’Œnanthe à feuilles de Peucédan Œnanthe peucedanifolia et la Scorzonère humble Scorzonera humilis) prélevés sur le territoire d’étude en 2021, et à analyser ces données afin de comprendre de quelle manière les éléments du paysage influencent les flux de gènes pour les espèces étudiées.
Le.la stagiaire :- Réalisera les différentes étapes du génotypage des échantillons en laboratoire (à Cologne) ;
- Analysera les données recueillies et évaluera la connectivité des prairies humides et les éléments du paysage influençant la dispersion des espèces étudiées (à Clermont-Ferrand, avec des déplacements à prévoir à Pélussin)
- Participera aux inventaires de terrain des prairies humides (à Pélussin).
Ce travail sera fait en lien avec les chargés de mission du CBN Massif central, ainsi qu'avec les autres partenaires du projet (Chambre d'agriculture de l'Ardèche, Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, Parc naturel régional du Pilat). Les missions seront réparties entre du travail de biologie moléculaire en laboratoire et du travail d’analyse des données au bureau. Quelques journées de terrain seront également prévues.
- Etudiant·e en Master 2 ou équivalent, dans le domaine de l’écologie et de la génétique des populations ;
- Intérêt pour la flore et sa conservation ;
- Compétences en statistiques (GLMs, statistiques multivariées), utilisation du logiciel R ;
- Bonne connaissance du logiciel de système d'informations géographiques QGIS ;
- Des connaissances en écologie du paysage et des notions concernant le logiciel Graphab seraient un plus ;
- Expérience de travail de laboratoire en biologie moléculaire : extractions d’ADN, PCR, génotypage ;
- Maîtrise des outils de bureautique courants (Pack office/Open office) ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Autonomie, dynamisme, désir de vivre une expérience internationale ;
- Maîtrise de l’anglais (parlé, écrit), pour inclusion dans l’équipe internationale de Cologne ;
- Bonnes compétences rédactionnelles.
Le/la stagiaire sera co-encadré·e par Irène Till-Bottraud (GEOLAB), Juliette de Meaux (Université de Cologne) et Lisa Favre-Bac (CBNMC).
Indemnité forfaitaire de stage, 15% du plafond horaire de la sécurité sociale (soit en valeur 2021 environ 550 €/mois). Les frais de déplacement et d’hébergement lors des déplacements seront pris en charge. En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, une partie (à définir) du travail de bureau pourra être réalisée en télétravail.