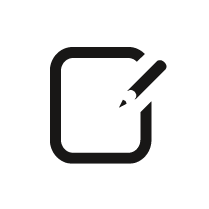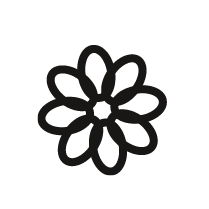Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Lancé en 1982 à l'initiative du Ministère de l’environnement, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d'identifier et de décrire, sur l'ensemble du territoire national, les secteurs de plus grand intérêt écologique abritant la biodiversité patrimoniale. Ces zonages ne constituent pas un outil règlementaire : ils contribuent à la connaissance environnementale du territoire national et ont vocation à alerter les porteurs de projets d’aménagement de toutes atteintes possibles sur la biodiversité remarquable.
En Auvergne – Rhône-Alpes, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a confié l’animation de cet inventaire continu sur la faune au CEN Auvergne pour la période 2017-2021, avec l’appui des autres CEN de la région ; et l’inventaire continu sur la flore aux Conservatoires botaniques nationaux.
Ainsi, ces dernières années, grâce aux soutiens de l'Union Européenne (FEDER Rhône-Alpes et FEDER Auvergne) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conservatoire botanique national a contribué à la réactualisation des données sur la flore et la bryoflore (mousses, hépatiques...) relatives aux ZNIEFF de la zone biogéographique du Massif central. Il s'agissait notamment de vérifier la présence d'une ou plusieurs espèces déterminantes pour chaque zone inventoriée.



Les ZNIEFF sont en effet généralement justifiées par la présence d'espèces dites déterminantes au regard de leurs intérêts intrinsèques (selon la méthodologie proposée par le Muséum national d'histoire naturelle).
Les inventaires conduits en 2019, 2020 et 2021 par les botanistes du CBN Massif central ont portés sur 327 ZNIEFF pour la flore et sur 159 ZNIEFF pour la bryoflore.
Les résultats montrent que sur 40% des ZNIEFF prospectées pour la flore, au moins une espèce déterminante de plante vasculaire a été observée en 2020 ou 2021 : en effet, 143 taxons déterminants ont été retrouvés sur 131 ZNIEFF.
En ce qui concerne la bryoflore, sur 159 ZNIEFF prospectées (129 en Auvergne et 30 en Rhône-Alpes), 58,5% présente au moins une bryophyte déterminante. Le nombre moyen d’espèces observées dans une ZNIEFF est de 1,7, avec un maximum de 6 espèces déterminantes observée au sein d’une ZNIEFF. Les données de bryophytes déterminantes ont été observées dans une gamme assez large de types d’habitats : forêts de montagnes, tourbières, sources, ruisseaux, étangs, complexes rocheux frais, …
Ces inventaires ont été l'occasion de trouver ou retrouver des espèces particulièrement rares parfois non connues sur certains territoires. C'est le cas par exemple du Capillaire des murailles à rachis épais (Asplenium trichomanes subsp. pachycharis), nouvelle fougère pour le département du Cantal ou encore de la Châtaigne d'eau (Trappa natans), redécouverte en Sologne bourbonnaise (Allier)...
Avec un peu de recul, malgré les nombreuses et heureuses découvertes, on ne peut que constater les atteintes croissantes portées sur de nombreux milieux depuis leur inventaire lors de la création des ZNIEFF, au début des années 1980 et réactualisé à la fin des années 1990. Et nombre de taxons mentionnés historiquement n'ont pu être retrouvés et ont très peu de chance d’être revus à l'avenir : 34 taxons déterminants n'ont pas été revus depuis 1950 sur les ZNIEFF à actualiser où ils étaient autrefois cités et parmi eux, 8 taxons sont en danger critique de disparition en Auvergne (4 en Rhône-Alpes). Le Doronic plantain, l'Euphraise des Cévennes ou encore l'Œnanthe de Lachenal ne seront très probablement jamais retrouvées sur le territoire et peuvent être considérées comme disparues.



Parmi les atteintes observées, la modification des habitats naturels, l’urbanisation et l’artificialisation des terres, ainsi que l’intensification ou l’abandon de certaines pratiques agricoles font figures de proue. Ces pressions exercées sur les plantes et leurs habitats sont rarement isolées : elles s’additionnent et conduisent, dans un effet de synergie, au constat qu'une plante sur 4 voire sur 5 est aujourd'hui menacée ou quasi-menacée de disparition.
Ainsi, certaines zones humides de montagnes se voient fortement impactées par le surpâturage qui entraine la destruction des végétations de surface, et par une eutrophisation globale conduisant à la disparition des espèces oligotrophes. Le drainage reste également une menace malgré la réglementation en la matière. En ce qui concerne les forêts, l’intensification actuelle de certaines pratiques sylvicoles contraint la maturité des habitats et par conséquent la survie de nombreuses espèces spécialisées, notamment celles étroitement liées aux bois morts ou aux arbres creux.
Ce vaste chantier a également permis de dégager plusieurs constats :
- La délimitation de certaines ZNIEFF serait à modifier pour mieux intégrer les taxons déterminants ou des ensembles de milieux à forte valeur patrimoniale : ZNIEFF morcelée en plusieurs entités, délimitation traversant une pelouse sèche, ZNIEFF déjà intégrée dans une autre… voire un travail de calage de la délimitation des ZNIEFF sur les parcelles cadastrales pour une meilleure prise en compte dans les documents d’aménagements ;
- La création de nouvelles ZNIEFF sur des zones présentant de forts enjeux floristiques et non identifiées dans les précédents inventaires ;
- La liste des espèces déterminantes pour la flore présente des espèces absentes d’Auvergne, trop difficiles à déterminer, ou encore exogènes au territoire) ; cette liste mériterait d'être retravaillée ;
- Avec un seuil de date d’obsolescence programmée à l’année 2013, un nombre important de ZNIEFF verront leurs données devenir obsolètes tout prochainement. Il conviendra donc dans le futur, conformément à la modernisation des ZNIEFF et à l’inventaire permanent, de trouver des solutions afin d’actualiser ces données devenues trop anciennes.
Plus globalement, si les ZNIEFF n’imposent pas de règlementation particulière quant aux pratiques humaines sur ces territoires, ce zonage garde tout son intérêt à travers les politiques d’aménagement du territoire, les zonages ZNIEFF permettant de faire connaître les zones sensibles en amont de travaux ou changements de pratiques.
L’actualisation des données qui vient d’être conduite renforcera la justification de ces zones à préserver. De plus les informations concernant les espèces inventoriées seront plus facilement accessibles aux aménageur et bureaux d’études (localisation précise par GPS).
Cette première phase d’actualisation a consisté uniquement à renforcer le réseau ZNIEFF existant. Toutefois, une révision de ces zonages devra être envisagée prochainement en particulier dans la perspective d’ajouter de nouvelles ZNIEFF qui mériteraient largement d’intégrer ce réseau.
Accéder au rapport techniqueGrâce aux soutiens de l'Union Européenne (FEDER Rhône-Alpes et FEDER Auvergne) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes